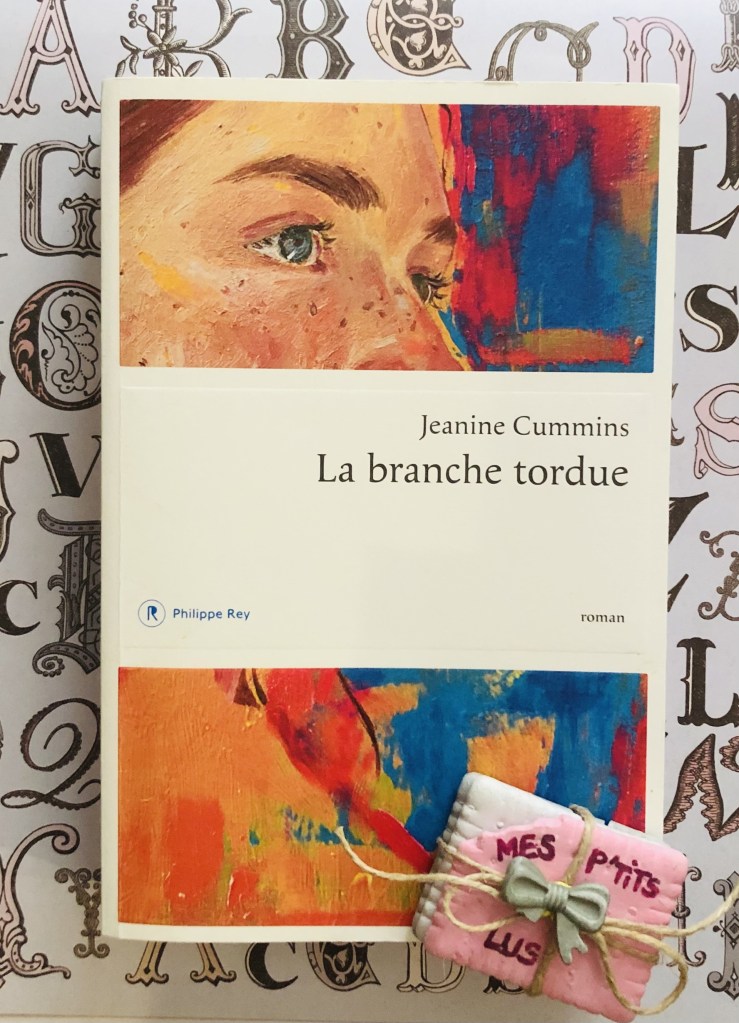
Majella est une jeune New-yorkaise, nouvellement maman de la petite Emma, à peine plus âgée que de huit semaines. Un désir d’enfant partagé avec son mari, Léo, mais que la réalité tempère grandement : Majella se débat dans son nouveau rôle, et nombreuses sont les larmes qu’elle laisse couler, de dépit et de frustration. De fait, sa vie d’écrivaine est mise en suspens, et rien ne la terrifie plus que les longues heures seule avec son bébé, pendant que Léo se donne corps et âme à son métier de chef cuisinier.
Et Majella de douter : est-elle une bonne mère ? Et si, finalement, elle avait fait une erreur ? Il faut dire que les relations avec sa propre mère sont très difficiles, voire inexistantes : Majella ne peut trouver en sa mère une oreille attentive à ses errements, car jamais cette dernière ne lui pose aucune question personnelle. Plus que jamais seule, Majella se prend à remettre en question son amour pour Emma : l’aime-t-elle comme il le faut ?
« Je crois que je ne suis juste pas la mère que je m’attendais à être. J’imaginais que je serais si maternelle et facile à vivre. […] Quand elle pleure, je… je suis une foutue loque. Moi qui avais cru que j’excellerais dans ce rôle. » (p.163)
Lorsqu’elle découvre dans le grenier familial le journal d’une certaine Ginny Doyle, ayant vécu au XIXème siècle en Irlande, Majella pense avoir affaire à une névrosée : en effet, l’écriture est hasardeuse et, surtout, elle y découvre l’aveu d’un meurtre devant l’une de ses filles. Majella vacille : se pourrait-il que son ascendance se soit construite à partir d’une branche tordue ? Cette mère de famille, qui a vécu en 1847 et en 1848 la Grande Famine irlandaise, est-elle à l’origine de ce qu’elle estime être sa propre défaillance en termes de maternité ? Porte-t-elle dans ses gènes les « tares » d’une ancêtre qui à tout jamais aurait souillé les membres féminins de sa descendance ? Est-elle condamnée à porter en elle cet héritage sanglant ?
« Il existe de nombreuses formes de folie, mais j’imagine que c’est surtout une question d’hérédité. Parfois, on peut même trouver son origine en remontant les branches mortes de son arbre généalogique ; en dénicher des preuves dans les anecdotes ou les documents familiaux. Une photo sépia. Un journal intime. Vous croyez avoir échappé à son emprise – vous croyez vous en être sortis. Mais elle est peut-être restée tapie, telle une tumeur, jusqu’à ce qu’un léger traumatisme la libère en vous. » (p.33)
Majella porte sur Ginny un regard très sombre, tout en masquant son propre trouble, sa fascination morbide pour cette femme depuis bien longtemps oubliée, dont l’histoire aurait pu rester des années encore sous la poussière d’un carton éventré.
« Je frissonne. Peut-être suis-je injuste. Peut-être n’était-elle pas aussi horrible qu’elle le paraît dans le journal. S’il existe une autre explication moins violente, plus facile à pardonner pour ses actes… Je ne sais pas, alors peut-être existe-t-il aussi une possibilité de rédemption. » (p.321)
Seul le lecteur peut, chapitre par chapitre, mettre à distance le jugement de Majella : parce que la narration entrelace l’Irlande de 1847 et le New-York d’aujourd’hui, nous savons que Ginny se saigne pour ses quatre enfants afin de leur donner à manger alors que son mari, Ray, sacrifie sa vie pour tenter sa chance à New-York et espérer envoyer quelques dollars aux siens, tandis que le mildiou laisse derrière lui des champs de pommes de terre désolés et ravagés. Une vie de misère et de renoncements alors qu’autour de la famille Doyle la mort rôde et fauche les plus fragiles, les plus faibles. Alors, comment imaginer que Ginny en soit venue à commettre un meurtre si l’on considère l’aveu que Majella découvre plus d’un siècle et demi plus tard ?
Formidable épopée féminine et féministe que ce roman de Jeanine Cummins, que l’on ne lâche pas tant le destin misérable et miséreux de Ginny et la vie de maman de Majella nous tiennent en haleine. Si tout semble les opposer, les relient pourtant la filiation et la maternité, érigeant en maîtres-mots le courage et la détermination. Deux beaux et touchants portraits de femmes, qui invitent le lecteur à relire la propre histoire de sa vie : de quoi son héritage affectif est-il fait ? De qui est-il la descendance ?
« Mais que se passe-t-il si on ne peut pas choisir ? Et si c’était encodé au plus profond de nos gènes et qu’on ne puisse pas y échapper ? Et si je faisais partie d’un cycle génétique de mères ratées auxquelles il est impossible d’échapper, et que je sois aussi sur le point de bousiller notre bébé ? » (p.282)
On pourrait se croire là face à un questionnement propre au déterminisme de Zola : nous n’en sommes en effet pas loin. Dans tous les cas, Jeanine Cummins nous invite à accueillir et chérir ce que nos aïeux nous ont donné de mieux. Et de cela, nul n’en est dépourvu…
La branche tordue, Jeanine CUMMINS, éditions Philippe REY, 2024, 444 pages, 24.50€.



Super ! Ça m’intéresse beaucoup. Dans la PAL !😉
Bonnes lectures et vacances 🌞
J’aimeAimé par 1 personne
Merci ! Très très bel été à toi aussi ! Et toujours autant de lectures bien sûr 😉
J’aimeAimé par 1 personne