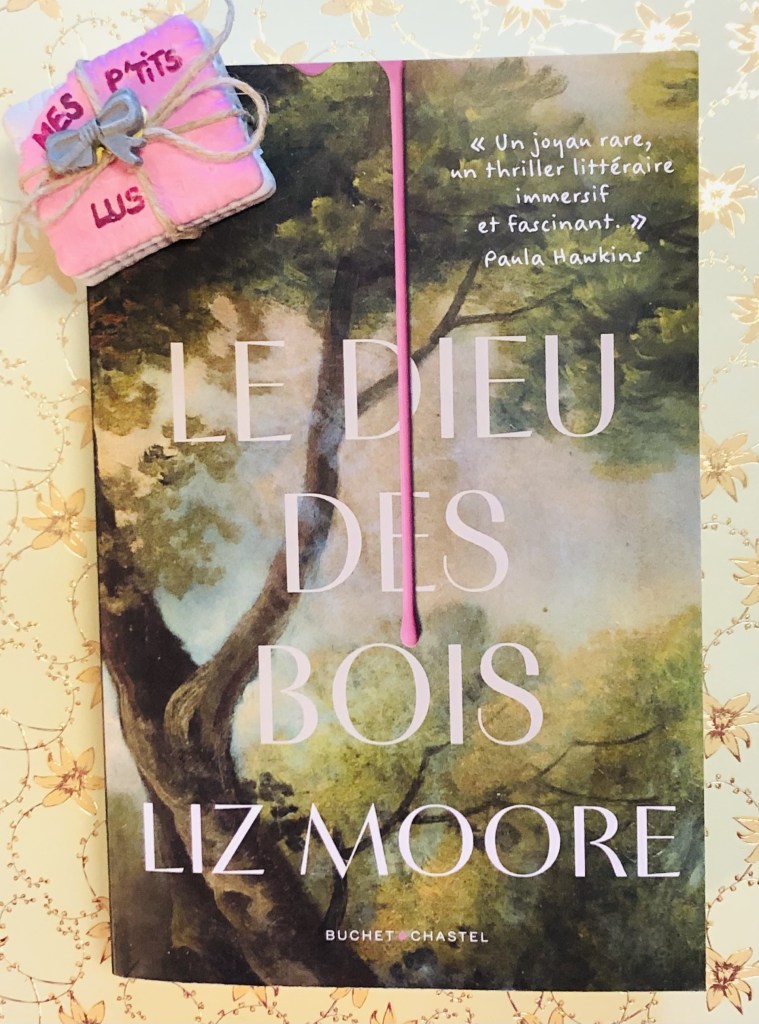
Le camp Emerson est idéalement situé depuis des décennies dans les Adirondacks, région montagneuse de l’état de New-York et richement peuplée de nombreuses et épaisses forêts. A l’origine, c’est une famille de laborieux forestiers qui avait le monopole de la contrée, mue par le respect de la Nature, mère nourricière de tant de bouches et pour tant de bras. Mais l’emplacement idyllique du lieu suscita dans la première moitié du XXème siècle la convoitise des Van Laar, dynastie de banquiers qui, de génération en génération, de Peter en Peter (puisque telle était la tradition de nommer ainsi le premier et unique fils de chaque génération), perdit en humanité : il ne leur fallut guère de temps pour procéder à la dépossession des terres et l’asservissement des petites gens du coin.
C’est sans scrupule que les Van Laar déboisèrent une large superficie d’arbres pour ériger leur imposante demeure et fonder, quelques centaines de mètres plus bas, une colonie de vacances où, chaque été, les enfants bien nés pourraient venir passer un mois pour cultiver l’esprit des bois et apprendre la survie en milieu hostile. Car, il est important de le souligner, les Adirondacks exercent certes un charme sur les randonneurs, mais l’épaisseur de leurs bois a tôt fait d’emprisonner les visiteurs inattentifs, dont les repères peuvent être effacés en un éclair. Il ne s’agit donc point de s’aventurer seul, sans précaution, à l’ascension du mont Hunt.
En cette année 1975, Barbara Van Laar, la plus jeune héritière de la dynastie, est inscrite de force à la colonie. Une occasion rêvée pour ses parents d’un peu de répit, l’adolescente étant particulièrement difficile à vivre. Ils pourront aussi ainsi organiser tranquillement leur fête annuelle, au cours de laquelle ils reçoivent artistes renommés ou futurs clients pour une semaine complète de ripaille joyeusement et copieusement arrosée. Un éclectisme tapageur aussi clinquant que le cristal des coupes, revendiqué et assumé.
« Un été tout entier sans Barbara, sans ses crises, ses tempêtes de rage, ses sanglots qui duraient des heures et troublaient le personnel. Tous avaient la politesse de faire semblant de ne rien entendre. Pourtant c’était le cas, pour chacun d’entre eux, comme pour Alice. Combien ce serait agréable d’avoir ces mois rien qu’à elle, sans sa fille, qui ne serait malgré tout qu’au pied de la colline, en sécurité. Occupée. Satisfaite. » (p.34)
Mais un matin, Louise, la monitrice, découvre dans la chambrée de son groupe que le lit de Barbara est vide : la jeune fille a disparu. Fugue ? Enlèvement ? Toutes les théories circulent, notamment les plus effrayantes avec celle d’un meurtrier en série en cavale, et qui par le passé a commis une série de crimes dans la région. Pourrait-il être de retour et sévir à nouveau ?
Hasard malheureux aussi : la disparition de Barbara réveille le passé traumatique de la contrée, puisque en 1961, le frère de Barbara, surnommé Bear, a lui aussi mystérieusement disparu, sans que son corps ne soit jamais retrouvé. La disparition avait suscité un grand émoi et provoqué une vague de drames corollaires à cette énigme. S’agit-il là d’un tragique bis repetita ?
« C’est la fille des Van Laar qui a disparu. Une adolescente de treize ans, qui a les mêmes parents que le garçon qui s’est volatilisé plus de dix ans auparavant. » (p.174)
Les fils narratifs, aussi nombreux que les personnages de ce foisonnant et passionnant roman, tissent et détissent des hypothèses, éclairant tantôt la mère de Barbara, une jeune femme littéralement dépossédée de sa volonté par un époux tyrannique ; tantôt la timide Tracy, nouvelle amie de Barbara au sein du camp, ou encore Judyta, l’inspectrice nouvellement diplômée et qui doit faire ses preuves dans un milieu tellement patriarcal.
C’est d’ailleurs là l’une des richesses littéraires du roman, outre l’intrigue palpitante pour résoudre la disparition de Barbara : Liz Moore offre une place de choix à une galerie de personnages féminins en prise avec des hommes pour la plupart toxiques et méprisants. Incarnations viriles et assumées d’un patriarcat ici dénoncé, ces hommes relèguent dans l’ombre des femmes qu’ils musèlent sciemment. Autre richesse, celle de la thématique sociale : Liz Moore pointe du doigt les mœurs des nantis, leur dépravation (oh, ces fêtes dionysiaques où l’alcool coule à flot et noie toutes les règles de bienséance) et la tyrannie qu’ils exercent sur les autres au nom de la supériorité de leur caste. L’auteur critique l’exploitation et le mépris dont sont victimes tant les femmes que les plus modestes : satire des satyres modernes.
On le comprendra, ce roman est d’une très grande richesse. Il nous fait alterner les temporalités ainsi que les voix narratives, d’où une épaisseur littéraire conséquente. Il s’agit, tant au sens propre qu’au sens figuré, de survivre en milieu hostile : celui de la forêt, en premier lieu, et celui du cadre mondain et tyrannique des puissants de ce monde en second lieu. Lequel des deux est le plus redoutable ? Le dénouement du récit vous le fera savoir…
« Tout le monde semble penser qu’une fugue est l’explication la plus probable, mais elle craint, elle, qu’il s’agisse d’autre chose. » (p.193)
Le dieu des bois, Liz MOORE, traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delarbre, éditions BUCHET CHASTEL, 2025, 508 pages, 24€.



Je crois bien que je vais adorer ! Les personnages, la forêt, les hommes tyranniques… et la gamine disparue, tout pour faire un bon roman !
Bonnes futures lectures à toi.😉
J’aimeAimé par 1 personne
Tu vas adorer ! Merci et à toi également 🙂
J’aimeAimé par 1 personne