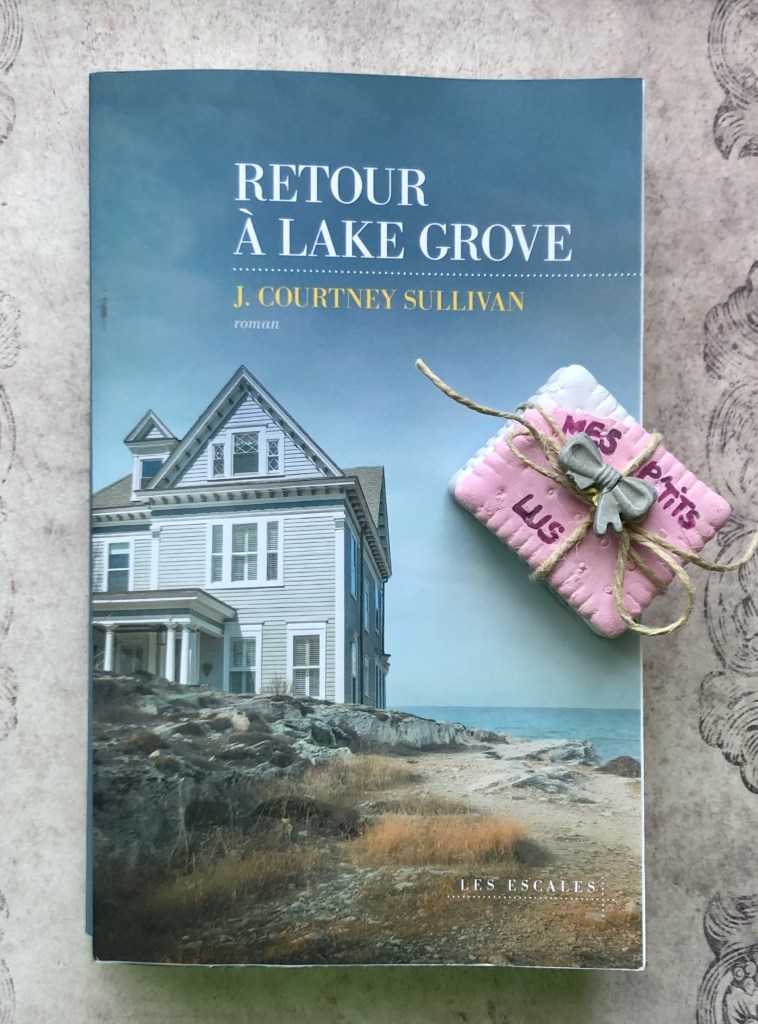
A plus de trente ans, Jane retourne, presque contrainte et forcée, à Awadapquit, une bourgade paisible historiquement célèbre pour ses vestiges autochtones et l’empreinte supposée victorieuse des premiers colons.
Pourtant, cette ville de son enfance, Jane a voulu la fuir à tout prix plus jeune : partir loin de sa mère, une alcoolique notoire, et de sa sœur, parfaite copie de leur génitrice. Seulement, malgré une lutte tenace pour ne pas sombrer elle-même aux sirènes de l’alcool, Jane a elle aussi succombé à partir de ses vingt ans. Jusqu’à l’erreur fatale sur son lieu de travail et la mise à mal de son couple avec David.
A Awadapquit, Jane retrouve deux maisons ; celle de sa défunte mère, dans un état aussi pitoyable que l’était sa propriétaire, et celle, chérie dans sa jeunesse bien qu’abandonnée, sur la falaise qui surplombe la mer. Plus jeune, c’est là qu’elle se réfugiait pour lire et s’évader.
« Elle y allait pour lire en paix, pour fuir le psychodrame du moment à la maison, pour contempler l’océan. Elle savait évidemment que cet endroit ne lui appartenait pas, mais avait tout de même l’impression contraire. » (p.22)
Mais quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’une riche Bostonienne a, au prix de millions de dollars, modernisé la villa d’antan, Lake Grove Inn. Pire encore : Jane découvre, horrifiée, que le petit cimetière privé et paisible a été supprimé pour y mettre une piscine. Aussi ne faut-il alors peut-être pas s’étonner que Benjamin, l’enfant de la propriétaire, voie le fantôme d’une petite fille chaque nuit apparaître face à lui dans sa chambre et discuter à n’en plus finir.
« Je vous assure, cette maison est en proie à une malédiction. Toutes les femmes qui s’y installent finissent seules. » (p.185)
Ainsi, tout le roman est une histoire de fantômes : ceux de notre vie, que l’on tient à distance et qui nous hantent. Pour Jane, il s’agit du souvenir chéri de sa grand-mère adorée mais aussi de son cheminement erratique d’alcoolique ainsi que du manque inhérent de sa mère. Mais, au-fur-et-à-mesure que nous tournons les pages, nous découvrons aussi les vies et les voix des « fantômes » qui ont arpenté la demeure victorienne de Lake Grove Inn : la dévouée Hannah, veuve trop tôt d’un mari trop longtemps attendu de ses périples en mer ; sa tendre domestique Eliza ; puis, de nombreuses décennies après, Marilyn l’artiste, mère éprouvée, mère endeuillée par les manquements, aux conséquences tragiques, de son mari…Et puis il reste toutes ces voix ancestrales, largement oubliées, qui ont été muselées par l’arrivée triomphale et despotique des colons : celles des amérindiens du Maine, peuple massacré aux richesses pillées et érigées, de façon plus ou moins licite, en trophées.
Alors, le roman se fait foisonnant, parfois même à la limite de l’exposé théorique lorsque le personnage de Jane plonge dans les archives des peuples autochtones pour essayer de répondre à la demande de la nouvelle propriétaire de Lake Grove de comprendre le passé de la demeure afin de mieux expliquer les phénomènes étranges qui s’y passent. On se prend à soupirer de la longueur du propos, certes intéressant, mais qui pêche par excès de zèle didactique.
Destinées de femmes, trajectoires filiales, prisme d’un passé éclaté qu’il convient de ré-interroger et de ré-intégrer à l’histoire américaine avec les honneurs, le récit de J. Courtney Sullivan croise les thématiques, jusqu’au trop-plein. On saura néanmoins lui reconnaître, à travers une critique évidente des actes des colons envers les peuples primitifs, l’apologie d’un retour aux sources, celui qui célèbre les valeurs ancestrales d’un âge d’or oublié et méprisé.
Enfin, parmi le foisonnement étourdissant des fils narratifs, je retiens cette invitation à considérer, que ce soit dans des archives, des objets du passé ou des pierres tombales oubliées, les voix que l’on n’entend plus : qu’auraient-elles pu dire, si la parole leur avait été donnée ? Comment ne pas trahir, au présent, ce qui fut autrefois et que l’on ignore maintenant / encore, sciemment ou non ?
« Jane ne croyait ni aux fantômes ni au paradis, mais elle croyait au pouvoir des histoires, écrites, racontées et transmises sous formes d’objets qu’on laissait derrière soi. » (p.146)
Une réflexion romanesque sur l’Histoire d’une grande richesse, fruit d’un évident travail remarquable d’écriture.
Retour à Lake Grove, J. Courtney SULLIVAN, traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Bouet, éditions LES ESCALES, 2025, 471 pages, 23€.


