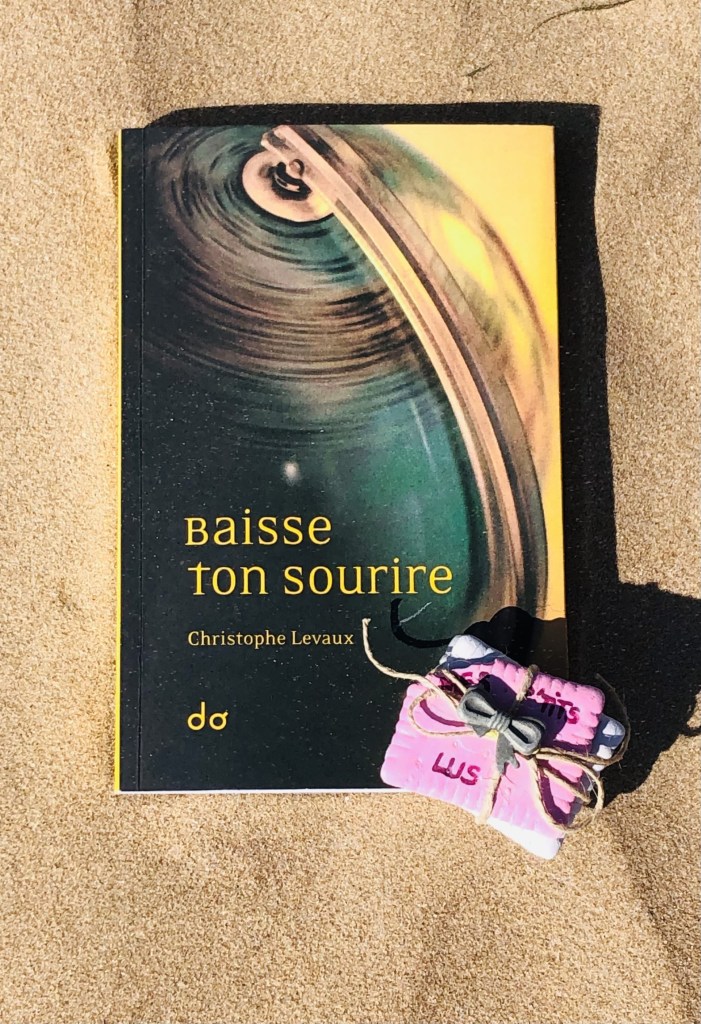
Le narrateur, anonyme, mène son récit de vie à la première personne du singulier. Et sans doute faut-il cela pour oser assumer un parcours de vie médiocre, plombé par l’absence d’une quelconque perspective à échapper au déterminisme gluant de « Toxcity », trou paumé d’une province du Nord.
La vie ne l’a pas aidé, cela est chose sûre : une grand-mère besogneuse à la vie littéralement de « merde », un père mutique et bagarreur, une mère soumise et effacée, un frère à l’ergo aussi développé qu’un coq, une famille dans laquelle l’amour est sciemment tu. Cette absence de communication et d’affection originelle est plutôt relayée par les gestes, rarement tendres, souvent violents. Et tout autour, l’alcool, l’ennui, la vulgarité, la morosité d’un paysage terne : l’annihilation de tout rêve.
« A la maison, quelque chose de froid pesait dans l’atmosphère. […] Chez nous, on ne se touchait pas et on ne disait pas je t’aime. Ça ne faisait pas partie des mœurs. » (p.10)
Le narrateur avorte ses études : l’ascenseur social, à sa portée, n’est emprunté que pour quelques mois. Très vite, il préfère travailler. Un prétexte idéal pour fuir le domicile familial, stérile de toute empathie.
Lors d’une soirée, il rencontre Sophie. Elle aussi vient d’un milieu désargenté mais n’a de cesse de vouloir s’extirper du marasme social dans lequel elle est née. Fuir, pour un ailleurs normalement meilleur. A deux, lorsque l’on est amoureux, la vie semble déjà plus jolie. De fait, les tourtereaux profitent d’une parenthèse enchantée le temps (fugace) que dure leur passion.
« Il apparaissait également que la vie d’avant n’avait aucune espèce de saveur et qu’on n’en savait alors rien. Avec Sophie, tout devenait enivrant et effréné. » (p.39)
Mais « mauvais sang » ne saurait mentir et la violence qui coule dans les veines du narrateur l’amène doucement mais sûrement à reproduire le schéma familial destructeur : à la moindre contrariété que lui « inflige » Sophie, elle doit payer. Rares sont les coups… au début. C’est plutôt un mur qui prend, ou encore un vase. Les réconciliations sont aussi passionnelles que les querelles. Mais la haine va grandissant : frustration sociale mêlée de honte identitaire créent une bombe à retardement pour le narrateur. Sophie lui pardonne : elle le sait, elle l’aime. Jusqu’au coup de trop. Les ravages de l’amour, au sens propre du terme, mènent tout droit au drame. De salut il n’y aura point. Pas faute d’avoir essayé, d’avoir espéré, d’avoir persisté. Mais sans doute, comme dans une tragédie recontextualisée dans un cadre sordide, cela était écrit…
« Peut-être que ça a commencé comme ça, avec des mots et des gestes dont on ne mesurait ni la teneur ni la portée, à l’entrée d’un cinéma, à l’arrière d’une cuisine ou au volant d’une voiture en début de soirée. Ça a commencé avec des paroles inconséquentes, et puis pas tellement au fond, car une fois semés, les mots s’étaient mis à vivre leur vie propre dans l’obscurité. » (p.56)
Baisse ton sourire est un uppercut littéraire, où les mots sont assénés avec une force inédite, littéralement crachés pour mieux signifier la carence affective qui détermine les personnages. Sophie, au phrasé plus riche de par sa volonté à s’élever, fait les frais de ses prétentions… Un roman social dans toute sa puissance, un récit d’amour fulgurant, un drame passionnel comme il en advient hélas tant…
« Ça donnait parfois le vertige : il semblait que l’escalade ne trouvait jamais de sommet, ou que le dénouement ne pouvait s’inscrire que dans notre propre destruction. » (p.89)
Et le lecteur de se questionner : le déterminisme est-il inéluctable ? Le narrateur n’a-t-il pas au fond de lui la possibilité de choisir ? Des essais, dans le roman, il y en a. Plus ou moins nombreux, plus ou moins heureux. Et si tout cela était en fait une question de volonté ?
« C’est sûr qu’elle m’aura bien déçu, cette vie, ou une partie du moins, qui n’aura tenu aucune de ses belles promesses en matière d’accomplissement personnel. » (p.117)
On retiendra en particulier de ce court récit le monologue final de notre anti-héros, qui dans une forme d’expiation vomit le fiel, l’amour, la haine, la douleur, les carences, la culpabilité… Une logorrhée vertigineuse pour tenter d’expier l’inexcusable, l’impardonnable.
« Je ne suis pas beau avec toi, putain. Je sais que ce n’est pas que toi, c’est pas de ta faute seulement ; c’est notre relation : elle me rend moche, et brutal, et con. » (p.129)
Pardonnez-moi de conclure cette chronique avec une formule on-ne-peut-plus familière, mais « ça calme », un livre comme cela. On le referme, sonné(e). Preuve que les mots n’en diront jamais assez lorsqu’il s’agit de dénoncer.
Baisse ton sourire, Christophe Levaux, éditions DO, 2023, 143 pages, 17€.


